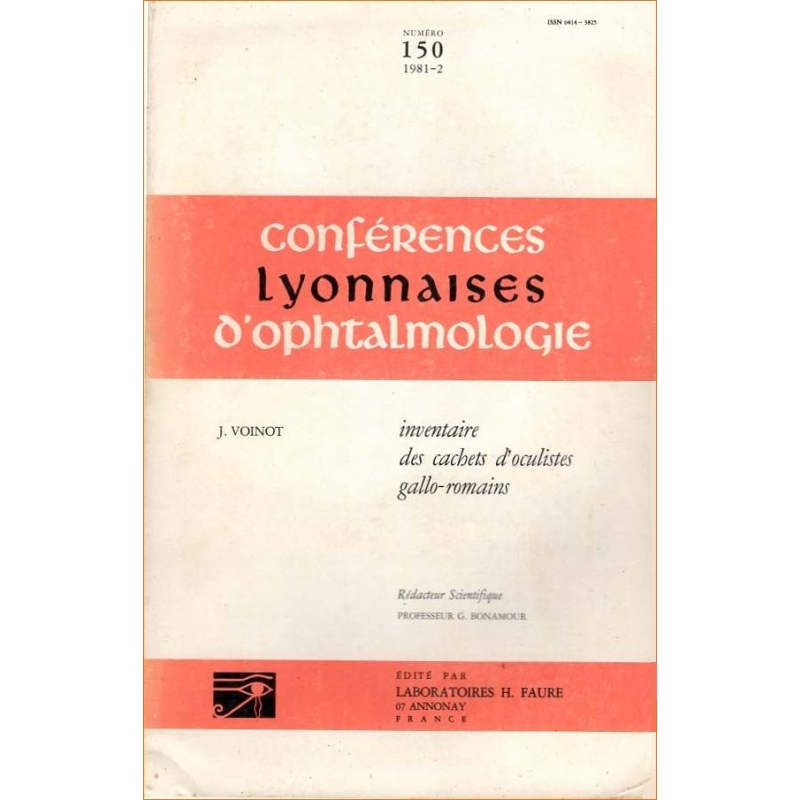
Reference :: DLGM-150508-03
Publisher :: Edizioni Accademia Vivarium novum
Reference :: DLGM-150508-03
Publisher :: Edizioni Accademia Vivarium novum
Reference :: DLGM-060421-01
Publisher :: Librairie Hachette
Reference :: DLGM-150508-01
Publisher :: Edizioni Accademia Vivarium novum
Reference :: DLGM-231009-02
Publisher :: Ophrys
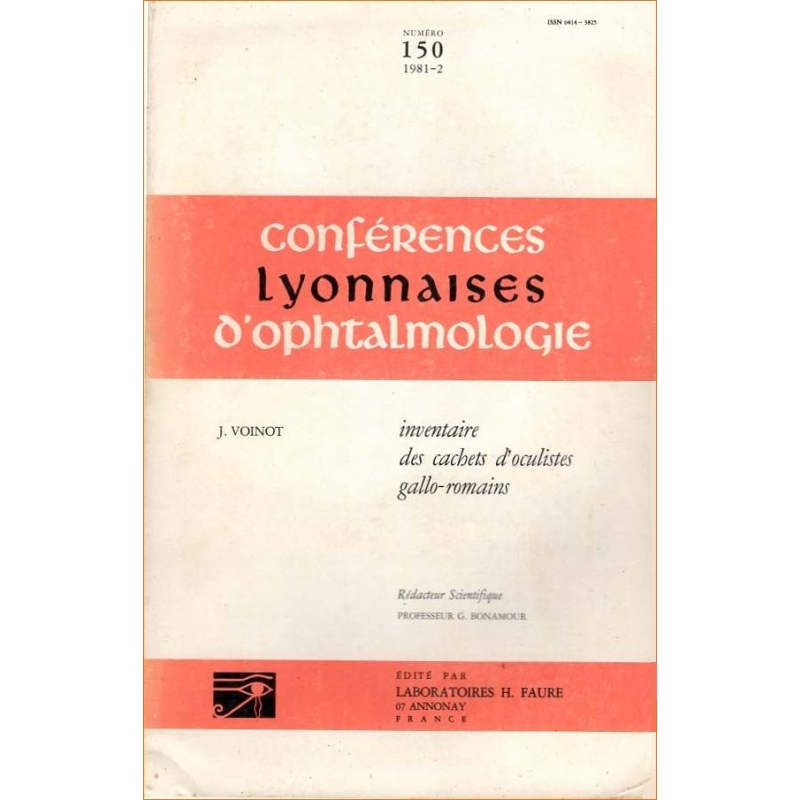
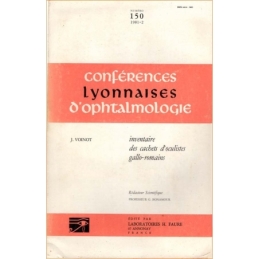
Conférences lyonnaises d'ophtalmologie, n° 150, 1981-2
► Voinot, J.
En français,
Collection Premier cycle,
Laboratoires H. Faure, 1981,
15,5 x 24, 578 pages, broché, occasion.
Nombreuses figures NB dans le texte. 1 planche hors texte couleur.
Bon état. Couverture légèrement défraîchie.

Security policy

Delivery policy

Return policy
• S'il est dans l'histoire du médicament une forme pharmaceutique remarquable par son unité, c'est bien, comme Michel H. Faure le souligne dans son introduction à cet épais volume, celle des « collyres secs » en usage aux IIe-IVe siècles principalement dans la Gaule romaine. Ces bâtonnets à base d'un nombre limité de substances (les principales étant les sulfates de cuivre et de zinc, la chélidoine et la myrrhe), recevaient avant dessication l'empreinte du cachet de leur auteur et s'administraient par dilution suivie d'instillation. Leur emploi se limita à la période gallo-romaine et semble, à en juger par la fréquence et la répartition des découvertes, ne s'être que faiblement répandu dans les territoires soumis à la pénétration romaine autres que la Gaule.
• Le système qui consistait à imprimer dans la pâte molle le nom de l'oculiste fabricant — qui comporte généralement praenomen, gentilicium et nomen — , l'appellation du collyre et les indications médicales du produit fait des collyres gallo-romains un parfait précurseur de la spécialité pharmaceutique. Les cachets utilisés à ces fins sont le plus souvent, et avec toutes sortes d'exceptions, rectangulaires, en serpentine ou en steatite, d'un à un et demi centimètre d'épaisseur, et portent les indications en question sur leurs petits côtés. Les renseignements qu'ils fournissent sont de première importance pour l'histoire de l'ophtalmologie et pour celle du médicament et de la matière médicale.
• A l'issue du XIXe siècle, période où la plupart de ceux que nous connaissons ont été découverts, Emile Espérandieu en publia, en 1905, dans le Corpus inscriptionum latinarum, sous le titre de Signacula medicorum oculariorum, un très savant et très complet inventaire fort de 231 numéros, qu'il compléta en 1927, dans la Revue archéologique, par la description de 27 autres pièces. En 1974, dans l'excellente étude de fond Ancient ophtalmological agents que nous avons analysée ici-même (R.H.P., n° 230, sept. 1976, p. 196-7), Harald Nielsen en dénombrait huit de plus. Et voici que l'inventaire du Dr Voinot porte le nombre total des cachets publiés à 284. Ils ont été trouvés essentiellement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Espagne (Caceres, n° 252 ; Coca, n° 274 ; Tarragone, n° 166), en Italie (Aquilée, Este, Rome, Syracuse), en Hongrie (n° 204), en Roumanie (n° 233) et en Algérie (Lambèse, n° 101). Un certain nombre ont disparu et ne nous sont plus connus que par la publication qui en a été faite. Les autres sont disséminés dans une cinquantaine de musées et de collections.
• L'inventaire du Dr Voinot se présente sous forme de fiches qui donnent pour chaque pièce l'indication sommaire de la date et du lieu de sa découverte, de ce qu'elle est devenue et de ses caractéristiques physiques, la transcription pure et simple du texte épigraphique et la référence de la première publication. Il ne saurait donc remplacer le catalogue d'Espérandieu, dont il ne reproduit pas toutes les précisions, bibliographiques notamment, pas plus qu'il ne donne l'interprétation développée des inscriptions abrégées.
• Les fiches sont elles-mêmes présentées et numérotées dans l'ordre chronologique de la découverte ou de la première publication de chaque cachet — ce qui ne va pas sans arbitraire quand la date de découverte n'est connue qu'approximativement. C'est un mode de classement certes intéressant et dans certains cas commode. Mais il oblige le chercheur qui s'intéresse à une pièce dont il ignore la date de découverte ou de publication ou qui ne connaît que la seconde et pas la première à passer par l'intermédiaire d'une des tables dont l'ouvrage est pourvu. Il est vrai que pas plus en ce domaine qu'en tout autre il n'est de classement parfait...
• Enfin, l'auteur s'est efforcé d'accompagner chaque notice de photographies ou, à défaut, de dessins. C'est l'un des intérêts majeurs de son travail. On voit mal dès lors pourquoi plusieurs cachets ne sont pas reproduits alors que le dessin — il est d'une admirable fidélité — s'en trouve chez Espérandieu (n° 93, 131, 171, 207, 215 de Voinot, par exemple, et encore la très curieuse face du n° 55 représentant un cheval marin), ou qu'ils figurent chez Nielsen (Voinot n° 255 et 260 ; Nielsen fig. 16-17).
• L'ouvrage a été conçu et imprimé avec un soin auquel n'ont échappé que des détails sans conséquence. Ainsi : Néris-les-Bains situé dans la Somme au n° 92 ; ordre chronologique inversé entre les nos 17 et 18-19 ; Caisterby devenant Caistor by au n° 245 et dans l'index.
Les réserves que je formulerais pour ma part tiennent au parti bibliographique adopté par l'auteur. En premier lieu, en effet, ne citer dans la bibliographie de chaque notice que la seule première publication du cachet n'est pas suffisant pour faciliter la tâche du chercheur. Ainsi, pour le n° 17 (Espérandieu n° 90), après publication en 1890 dans le Bulletin des Antiquaires de France, Espérandieu a lui- même jugé nécessaire de revenir sur le sujet dès la même année dans un long et magistral article de la Revue générale d'ophtalmologie, où il fait état de nouveaux éléments. A noter, au passage, que de l'avis d'Espérandieu le cachet en question devait être non de marbre, mais de serpentine ou de stéatite et qu'on ne saurait écrire qu'il a été publié le 26 janvier 1753, date qui est celle d'une lettre privée de l'abbé Lebeuf. En second lieu, pourquoi n'avoir pas repris dans la bibliographie terminale l'ensemble des publications citées dans le corps de l'ouvrage ? La liste ne s'en serait pas trouvée allongée de beaucoup, le lecteur aurait eu une vue d'ensemble des travaux utilisés par l'auteur et ce dernier aurait été dissuadé d'employer dans l'inventaire le peu commode op. cit., qui oblige à remonter de page en page.
• Bien entendu, l'ouvrage du Dr Voinot comporte une série de tables : un tableau chronologique qui reproduit, en résumé, l'inventaire lui-même ; un index alphabétique des nomina des oculistes et un des cognomina ; un index alphabétique des « lieux de trouvaille » (je préférerais « découverte ») des cachets ; un tableau de concordance entre la numérotation d'Espérandieu et la nouvelle ; la liste des moulages conservés au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. C'est beaucoup et c'est, pour une part, indispensable... et pourtant il y manque l'index alphabétique des lieux de conservation qui seul permettrait de vérifier directement si tel cachet figurant dans un musée ou une collection est bien déjà connu.
• Pour leur 150e numéro, les Conférences lyonnaises d'ophtalmologie, lancées en 1954 et qui ont de longue date étendu leur audience à toute la France et à travers le monde, ne pouvaient trouver mieux que le gros travail du Dr Voinot. Il fera date dans l'histoire de cette publication. Date aussi dans l'historiographie de l'ophtalmologie et plus généralement de la médecine et de la pharmacie : en rendant plus accessible l'essentiel de l'inventaire d'Espérandieu, en apportant à ce même inventaire un très important complément, en rassemblant une iconographie sans égale, ce numéro exceptionnel constituera pour les historiens de ces disciplines un précieux instrument de travail. Et l'on rendra grâce, une fois de plus, aux Laboratoires H. Faure, dont la réputation en matière d'ophtalmologie n'est plus à faire, d'en avoir assumé l'édition.
Julien Pierre. Un nouvel inventaire des cachets d'oculistes : Jacques Voinot, Inventaire des cachets d'oculistes gallo-romains. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 72ᵉ année, n°262, 1984. pp. 290-292.
Book information
No customer reviews for the moment.
Reference :: PPEA-071111-06
Publisher :: Editions Errance
Reference :: LPPEA-67
Publisher :: University of London - Institute of Classical Studies
Reference :: PPEA-100109-01
Publisher :: Editions Rue d'Ulm/Presses de l'Ecole normale supérieure
Reference :: PPEA-260909-05
Publisher :: University of Thessaloniki
Reference :: PPEA-230611-28
Publisher :: Ecole Française d'Athènes
Reference :: PPEA-110810-05
Publisher :: Paris, Imprimerie nationale
Reference :: LPPEA-73
Publisher :: University of London
Reference :: PPEA-170211-25
Publisher :: IFEA Georges Dumézil/De Boccard
Reference :: PPEA-050509-11
Publisher :: Ernest Thorin
Reference :: PPEA-230611-33
Publisher :: Ecole Française d'Athènes
Reference :: PPEA-140814-04
Publisher :: Centro internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi
Reference :: PPEA-090508-16
Publisher :: Verein Kurtrierisches Jahrbuch, Trier
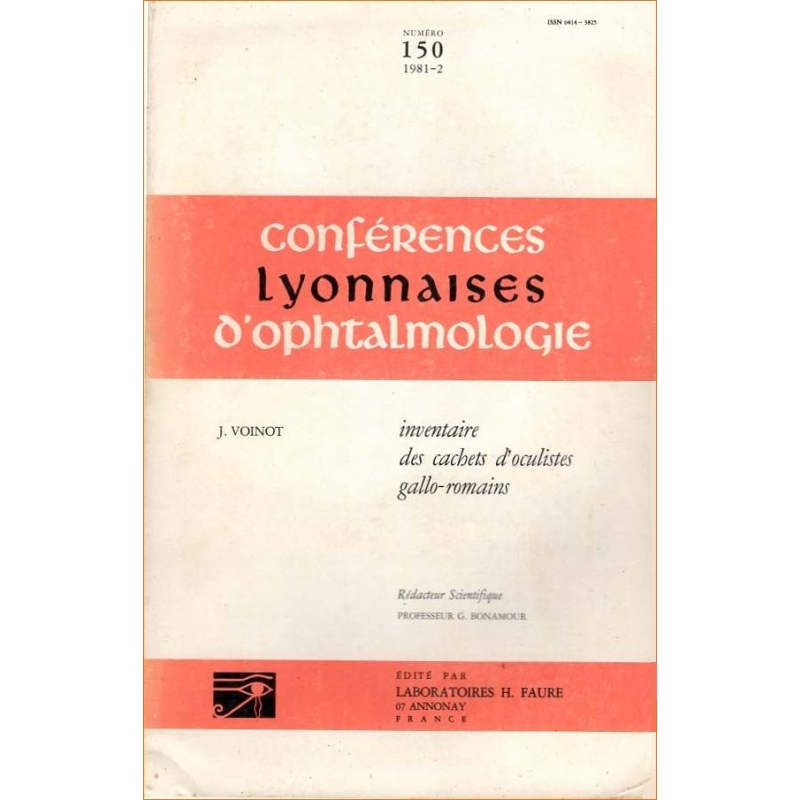
Conférences lyonnaises d'ophtalmologie, n° 150, 1981-2
► Voinot, J.
En français,
Collection Premier cycle,
Laboratoires H. Faure, 1981,
15,5 x 24, 578 pages, broché, occasion.
Nombreuses figures NB dans le texte. 1 planche hors texte couleur.
Bon état. Couverture légèrement défraîchie.